
 |
|
Le territoire japonais est composé de quelques 6 800 îles mais les quatre plus vastes représentent l'essentiel des 378 000 km² de l'archipel : il s'agit du nord au sud d'Hokkaido, de Honshu ("le pays principal"), de Shikoku et de Kyushu. S'y ajoutent de modestes archipels comme les îles Ryu-Kyu au sud et quelques îles du Pacifique Ouest. Ils offrent au Japon un vaste domaine maritime de 4,5 millions de km² à l'intérieur de la zone des 200 milles marins, soit environ douze fois sa superficie émergée. Le Japon forme donc un ensemble insulaire dont les côtes s'étendent sur plus de 30 000 km. Il est entouré de cinq mers principales : la Mer du Japon (nihonkai), le Pacifique (taiheiyô), la Mer de Chine Orientale, la Mer d'Okhotsk et la Mer Intérieure.

Ce territoire apparaît d'autant plus fragmenté qu'il s'étire sur plus de 2 000 km. entre le 24° et le 46° de latitude nord. Les plus proches voisins sont des Etats du continent asiatique, les deux Corées, la Chine et la Russie avec lesquels le Japon entretient des relations intenses mais parfois tendues.
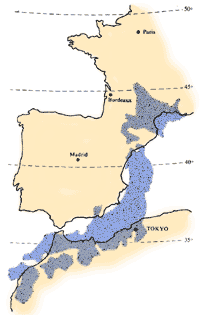
Les montagnes et les collines aux versants abrupts occupent 84 % de la superficie totale du Japon. Les monts Ida dépassent parfois 3 000 mètres d'altitude, formant une dorsale vigoureuse au centre de Honshu. Soumis à un intense ravinement, ces reliefs font obstacle aux communications entre les grandes façades maritimes. Les plaines ne couvrent dès lors que 16 % du territoire. Formant de modestes dépressions au coeur des montagnes ou s'ouvrant sur le front de mer, elles concentrent en fait la quasi totalité de la population et des activités économiques. Ainsi la plaine du Kanto au sud-est est totalement occupée par la gigantesque agglomération de Tôkyô.
Les quelques 126 millions de Japonais se concentrent sur 375 000 km², soit les 2/3 de la France. La densité moyenne de 334 habitants au km² masque de forts contrastes de peuplement. Elle demeure somme toute banale dans ce "monde plein" qu'est l'Asie Orientale. Affirmer que le Japon manque d'espace est inexact : l'entassement réel des hommes et des activités dans les plaines littorales résulte d'un choix culturel privilégiant une mise en valeur intensive de l'espace.
La situation de l'archipel explique l'instabilité de l'écorce terrestre à cet endroit. Le Japon appartient dans son entier à " la ceinture de feu du Pacifique ". L'archipel est né de la subduction entre les plaques océaniques du Pacifique et des Philippines et la plaque continentale eurasiatique.
Les sommets sont souvent d'origine volcanique. Le Mont Fuji-San, devenu l'emblème du pays, en est l'exemple le plus fameux avec ses 3776 mètres couronnés de neiges. Environ soixante volcans sont encore en activité. Sous haute surveillance, leurs éruptions présentent cependant un danger moindre que les tremblements de terre.
Les secousses sismiques (jishin) sont quotidiennes dans l'archipel et les grandes catastrophes demeurent une menace permanente pour la population. Tokyo fut dévastée en 1923 par un séisme qui fit 140 000 victimes. Le dernier tremblement de terre important, celui de Kobe le 19 janvier 1995 a, par son ampleur, montré les limites des mesures anti-sismiques et de l'organisation des secours lorsque le séisme frappait de plein fouet une région totalement urbanisée. Le risque est majeur d'autant que les épicentres sont particulièrement nombreux dans la partie centrale de Honshu, de loin la plus peuplée.
A ces risques s'ajoutent celui des typhons (naiphon), ces tempêtes tropicales qui frappent le littoral sud de l'archipel entre août et octobre, et celui des tsunamis, des raz-de-marée provoqués par des séismes sous-marins.
L'omniprésence des catastrophes naturelles entraîne chez les Japonais un sens de l'impermanence, un goût pour ce qui est éphémère ainsi qu'un sens aigu du moment qui passe. Domestiquer une nature tumultueuse a été et demeure un défi pour la société japonaise. L'art sophistiqué des jardins, des compositions florales ne sont-ils pas témoins du rêve d'une nature maîtrisée, soustraite aux excès du milieu ?
L'archipel appartient au domaine climatique de l'Asie des moussons, mais son insularité, son étirement en latitude et l'emprise des montagnes confèrent au climat japonais des traits originaux. Les saisons sont très tranchées : en hiver, les masses d'air froid venues de Sibérie apportent d'abondantes précipitations neigeuses sur Hokkaido et la côte nord de Honshu, en été, c'est l'air tropical, très chaud et saturé d'humidité, qui affectent le sud de l'archipel. Arrosé en toutes saisons, le Japon connaît donc surtout de violents contrastes thermiques.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La durée des saisons varie selon les régions :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'archipel compte quelques 33 000 km de côtes. Aucun point du territoire n'est à plus de 110 km de la ligne du littoral. La quasi totalité des Japonais est donc en contact avec la mer. Deux courants maritimes baignent les côtes japonaises : l'Oyashio, un courant froid qui descend du Pacifique nord et le Kuroshio, un courant chaud qui touche les régions méridionales de l'archipel. Ces deux courants atténuent les contrastes thermiques du pays. Leur rencontre à l'est de Honshu et dans la Mer du Japon offre au-dessus du plateau continental des conditions idéales pour faire de ces régions des eaux très poissonneuses car riches en plancton. Dangereuse parfois, la mer se fait ici nourricière.
L'insularité favorise sans expliquer la tentation qu'eut le Japon dans le passé de s'isoler du monde : loin de tout déterminisme, les périodes d'isolement, toujours relatif d'ailleurs, témoignent du regard porté par la société japonaise sur l'extérieur et les dangers réels ou supposés des contacts avec l'étranger. L'océan fut tour à tour une barrière et un lien. La mer offrit une protection efficace contre les influences étrangères aux XVIIIème siècle ; elle est de nos jours le vecteur de la toute puissance économique du Japon. "L'insularité japonaise, rappelle le géographe Philippe Pelletier, favorise aussi bien la fermeture (repli sur soi, finisterres) que l'ouverture (flux de civilisation, points de contact, échanges)" (Géographie Universelle, Reclus, tome "Chine, Japon, Corée", p. 250. La population japonaise est à 90 % concentrée à proximité immédiate du trait littoral. La remarque vaut à l'évidence pour les activités industrielles. Ce sont les besoins en matières premières et en énergie mais aussi l'essor des exportations qui expliquent la littoralisation industrielle. Mondialisation rime au Japon avec littoralisation ! Aussi le littoral est-il l'objet d'aménagements spectaculaires, en particulier les terre-pleins construits pour accueillir des équipement portuaires, des centrales thermiques et nucléaires, des combinats sidérurgiques et chimiques, des chantiers navals et des aéroports, autant d'infrastructures nécessitant de vastes espaces plans. Génératrice de pollutions, cette " industrie sur l'eau " concurrence fortement les autres activités littorales, le tourisme, la pêche et l'aquaculture.